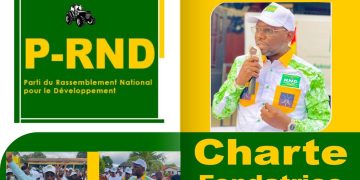La présente publication s’inscrit dans la série d’analyses consacrées au Programme Simandou 2040, cadre stratégique à long terme par lequel la République de Guinée oriente la gestion et la réaffectation des revenus issus du projet minier Simandou vers des politiques de développement durable et de diversification économique. Elle intervient dans le contexte du rebasage du Produit Intérieur Brut (PIB) réalisé en 2024 par l’Institut National de la Statistique (INS), qui a actualisé l’année de base de 2006 à 2018. Cette révision a entraîné une hausse de 51,2 % du PIB, désormais estimé à 36,3 milliards USD, en intégrant le secteur informel (42 % du PIB), les transferts de la diaspora et les activités numériques, offrant ainsi une mesure plus réaliste et inclusive de la structure économique guinéenne [1][2].

L’analyse se décline en trois volets clairement distincts. Premièrement, elle présente le projet minier Simandou, dont les paramètres techniques et financiers sont documentés : un investissement global d’environ 20 milliards USD, une production annuelle de 120 millions de tonnes de minerai de fer (MTPA) et 650 kilomètres d’infrastructures ferroviaires et portuaires [3][4]. Deuxièmement, elle examine l’architecture de financement du projet, structurée autour de 60 % de capitaux propres et 40 % de dette, ainsi que le régime fiscal spécifique générant entre 1,15 et 1,38 milliard USD par an pour l’État [5][6]. Et enfin, elle évalue l’impact macroéconomique anticipé, marqué par une hausse du PIB à l’horizon 2030 et la création d’environ 110 000 emplois directs et indirects [7][8].
Les données présentées dans cette étude concernent exclusivement le projet minier Simandou, dont les éléments financiers et macroéconomiques sont publiés par les institutions partenaires, tandis que le Programme Simandou 2040 reste un cadre programmatique national en cours de formalisation, sans estimation officielle consolidée de son coût global [2].
Mots-clés : Programme Simandou 2040, Projet minier Simandou, Viabilité économique, Rente extractive, Rebasage du PIB, Diversification économique, Transparence financière, Développement durable, Fonds de stabilisation, Transformation structurelle, Macroéconomie minière, Emploi et capital humain, Souveraineté économique.
Contexte Général – Trajectoire économique

L’économie guinéenne connaît une phase de transition structurelle sans précédent, marquée par une redéfinition de ses fondamentaux macroéconomiques et sectoriels. Le rebasage des comptes nationaux en 2024, qui a porté le PIB de 21 à 36,3 milliards USD [1], a repositionné la Guinée parmi les économies à revenu intermédiaire inférieur, traduisant une amélioration substantielle de la mesure de la richesse nationale et une meilleure intégration des secteurs émergents [2]. La structure économique en 2024 reflète encore les traits d’une économie en développement, dominée par le secteur tertiaire (43 % du PIB), soutenu par la télécommunication, le commerce et les services financiers. L’agriculture conserve un rôle structurant avec 24 %, tandis que l’industrie représente 19 %, dont 14 % attribués au secteur minier, principal moteur des exportations, et la construction complète la structure avec 14 % [2][3]. Cette composition met en évidence une économie encore dépendante des activités primaires et des services, mais amorçant une montée progressive vers l’industrialisation.
Les projections à l’horizon 2030 annoncent une transformation profonde de la structure du PIB, avec une croissance estimée à 56,8 milliards USD, soit une progression de 57 % en six ans [4]. Le secteur minier, porté par la mise en exploitation du projet Simandou, devrait voir sa contribution croître de 14 % à près de 28 %, dont 16 à 18 % provenant de Simandou à lui seul [1][2]. Cette évolution traduit la montée en puissance du capital extractif dans la création de richesse nationale, tout en annonçant un rééquilibrage de l’économie autour des infrastructures et des industries de transformation. En parallèle, la part des services devrait se stabiliser autour de 35 %, confirmant la maturité progressive du secteur tertiaire, tandis que l’agriculture reculerait légèrement à 20 %, en raison de la mécanisation et de la diversification de la production vers des filières à plus forte valeur ajoutée. Enfin, la construction progresserait à 17 %, soutenue par les grands chantiers miniers, énergétiques et logistiques associés au corridor Simandou. Ainsi, entre 2024 et 2030, la Guinée s’engage sur la voie d’une reconfiguration économique profonde, marquée par le passage d’une économie de services et d’agriculture à une économie productive fondée sur les ressources, la transformation industrielle et les infrastructures. Cette trajectoire confirme le potentiel de croissance inclusive du pays, à condition que la gestion des revenus miniers s’inscrive dans un cadre de gouvernance rigoureuse et de diversification durable.

Figure 1 : Transformation de la structure économique guinéenne (2024-2030)
Le secteur minier passe de 14% (2024) à 25-28% (2030), dont 16-18% pour Simandou.
Fondations du Projet de Transformation
La structure du gisement est organisée en deux ensembles géologiques complémentaires, répartis entre la partie nord et la partie sud du massif. Les blocs 1 et 2, situés au nord et opérés par Winning Consortium Simandou (WCS) en partenariat avec l’État, renferment environ 1,8 milliard de tonnes de réserves estimées à une teneur supérieure à 65,5 % Fe [14]. Les blocs 3 et 4, situés au sud et développés par le consortium Rio Tinto Simfer/CIOH avec la participation de l’État, concentrent pour leur part 2,9 milliards de tonnes, dont 1,5 milliard de tonnes de réserves prouvées (65,3 % Fe) et 1,4 milliard de tonnes de ressources additionnelles (66,1 % Fe) [12][13].

Cette configuration duale traduit une complémentarité technique et économique entre les deux pôles, permettant d’envisager une production combinée de 120 millions de tonnes par an, soit près de 6 % du commerce mondial du minerai de fer [17]. Elle illustre la volonté nationale de structurer le développement minier autour d’un modèle intégré, associant exploitation, infrastructures ferroviaires et valorisation industrielle, au service d’une croissance durable et inclusive.
Le Gisement de Simandou
Dans leur ensemble, les quatre blocs de Simandou forment un pôle minier intégré dont la production combinée est estimée à 120 millions de tonnes par an, soit près de 6 % du commerce mondial du minerai de fer [17]. Cette configuration confère au gisement une dimension stratégique unique, faisant de ce projet non seulement une source majeure de croissance économique et de recettes publiques, mais aussi un vecteur d’intégration territoriale et d’industrialisation nationale. Au-delà de sa vocation extractive, Simandou s’inscrit dans une logique de transformation structurelle par la création d’un corridor ferroviaire et portuaire transguinéen, véritable infrastructure de développement reliant les zones minières de l’intérieur au littoral atlantique. Ce corridor constitue une artère économique essentielle, destinée à stimuler les échanges commerciaux, à réduire les coûts logistiques et à encourager l’implantation de nouvelles activités industrielles le long de son tracé.
Sur le plan stratégique, Simandou représente une plateforme d’intégration régionale et un instrument de souveraineté économique, capable de renforcer la position géoéconomique de la Guinée dans la chaîne mondiale de valeur du fer. Son exploitation ordonnée et durable ouvre la perspective d’un redéploiement industriel appuyé sur la transformation locale des ressources et la montée en puissance d’un tissu productif national. Ainsi, le gisement de Simandou dépasse le statut de simple projet minier : il s’affirme comme un projet de nation, porteur d’une vision de développement durable, inclusif et intergénérationnel, capable de reconfigurer durablement la place de la Guinée dans l’économie mondiale.

Figure 2 : Répartition des réserves de minerai de fer du projet Simandou
Total : 4,7 Mdt | Blocs 3-4 : 2,9 Mdt (réserves prouvées + ressources) | Blocs 1-2 : 1,8 Mdt
Architecture de Financement
La structure de financement du projet Simandou repose sur un montage mixte d’une envergure exceptionnelle, totalisant approximativement 20 milliards USD. Ce montage combine 60 à 65 % de capitaux propres (12 à 13 milliards USD) apportés par les actionnaires du projet, et 35 à 40 % de dettes structurées (7 à 8 milliards USD) contractées auprès d’institutions financières internationales et d’agences de crédit à l’exportation [1][2][5]. Cette architecture financière reflète à la fois l’ampleur du projet et la confiance des investisseurs dans sa viabilité économique à long terme.
Les capitaux propres, représentant la composante majoritaire du financement (62,5 %), sont apportés par un consortium d’actionnaires internationaux et nationaux (voir Figure 3).
Rio Tinto Simfer, opérateur principal des blocs 3 et 4, constitue le premier investisseur avec une contribution estimée à 4,5 milliards USD (22,5 % du total), reflétant son rôle de chef de file technique et opérationnel [5][6]. Le groupe chinois Chalco Iron Ore Holdings (CIOH), partenaire stratégique sur les mêmes blocs, apporte environ 3,0 milliards USD (15 %), consolidant ainsi la dimension sino-africaine du projet [6]. Winning Consortium Simandou (WCS), opérateur des blocs 1 et 2, mobilise près de 2,5 milliards USD (12,5 %), tandis que l’État guinéen, à travers sa participation de 15 % dans les sociétés minières, contribue environ 2,0 milliards USD (10 %) en capitaux propres [4][9]. Le solde de 0,5 milliard USD (2,5 %) provient d’autres actionnaires minoritaires et d’investisseurs stratégiques.
La composante dette (37,5 % du financement total) se structure autour de trois piliers institutionnels complémentaires. Les institutions financières internationales (IFI), représentant 3,0 milliards USD (15 % du total), jouent un rôle central dans la sécurisation du financement et l’amélioration des standards ESG du projet. La Société Financière Internationale (IFC), bras du secteur privé de la Banque mondiale, apporte environ 1,8 milliard USD, tandis que la Banque Africaine de Développement (BAD) mobilise près de 1,2 milliard USD [5][6]. Ces institutions multilatérales offrent non seulement des capitaux à des conditions préférentielles, mais également un accompagnement technique et une garantie de conformité aux standards internationaux en matière de gouvernance et de durabilité.
Les agences de crédit à l’exportation (ECA) constituent le deuxième pilier de la dette, avec un montant total de 2,5 milliards USD (12,5 % du financement). Ces institutions, rattachées aux gouvernements des pays fournisseurs d’équipements miniers et ferroviaires, lient leurs financements aux contrats d’approvisionnement. L’agence chinoise SINOSURE, liée aux équipementiers et constructeurs ferroviaires chinois impliqués dans le projet, représente environ 1,5 milliard USD [5][7]. Les ECA d’autres pays (européens, japonais, sud-coréens) complètent le financement à hauteur d’environ 1,0 milliard USD, reflétant la diversité des fournisseurs d’équipements du projet. Cette structure ECA garantit l’alignement entre les intérêts commerciaux des pays exportateurs et le développement des infrastructures du projet.
Le troisième pilier de la dette regroupe les banques commerciales internationales, qui apportent environ 1,5 milliard USD (7,5 % du total) dans le cadre de financements syndiqués [5][7]. Ces institutions bancaires privées, attirées par la solidité du projet et la qualité de son consortium d’actionnaires, complètent le montage financier en offrant une flexibilité supplémentaire dans les conditions de décaissement et de remboursement. La présence de ces financements privés témoigne de la confiance du marché dans la rentabilité attendue du projet et dans la capacité de remboursement des sociétés minières.
La complexité de cette architecture de financement nécessite une gouvernance financière rigoureuse et des mécanismes de garantie sophistiqués. Les accords de financement incluent des clauses de partage des risques entre actionnaires et prêteurs, des mécanismes de couverture contre les fluctuations des prix du minerai de fer, et des garanties croisées entre les différentes entités du projet [5][6][7]. Les flux de revenus futurs du projet, incluant les redevances minières et les revenus d’exploitation, constituent la principale garantie pour les créanciers. Cette structure financière, bien que complexe, assure une répartition équilibrée des risques et des rendements entre les différentes parties prenantes, tout en préservant la capacité de l’État guinéen à bénéficier pleinement des retombées économiques du projet.
Pour mieux appréhender cette architecture financière et ses multiples composantes, la figure 3 offre une visualisation complète de la structure de financement du projet Simandou, évaluée à 20 milliards USD. L’illustration se compose de quatre éléments complémentaires qui permettent une lecture à plusieurs niveaux : premièrement, la structure globale du financement présentant les trois grandes catégories (capitaux propres, dettes IFI, dettes ECA et banques) ; deuxièmement, le détail des capitaux propres identifiant chaque actionnaire et sa contribution ; troisièmement, le détail des dettes décomposant les financements par créanciers institutionnels ; et quatrièmement, une synthèse récapitulative présentant les montants, pourcentages et composition principale de chaque catégorie.
Cette approche multi-niveau permet de saisir à la fois la vue d’ensemble de la structure financière et les spécificités de chaque source de financement. La répartition entre capitaux propres majoritaires (62,5%), dettes des institutions financières internationales (15%) et dettes des agences de crédit à l’exportation et banques commerciales (22,5%) illustre la stratégie de diversification qui sous-tend la solidité du projet. Cette structure témoigne également de la confiance des investisseurs et créanciers internationaux dans la viabilité économique et la pérennité du projet Simandou.
Figure 3 : Architecture de financement du projet (20 Mds USD)

Capitaux propres : 12-13 Mds (60-65%) | Dettes : 7-8 Mds (35-40%)

Régime Fiscal et Revenus de l’État
Le régime fiscal applicable au projet minier Simandou repose sur une architecture juridique combinant les dispositions du Code minier guinéen de 2011 (amendé en 2013) et les conventions minières spécifiques négociées entre l’État guinéen et les consortiums miniers [8][9]. Ce cadre fiscal diversifie les instruments de prélèvement pour équilibrer rentabilité des investisseurs et revenus publics substantiels, tout en assurant une transparence conforme aux standards de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE) [8]. Les cinq principaux instruments fiscaux sont : la redevance minière (5 % FOB), l’impôt sur les sociétés (30 % des bénéfices), la taxe d’extraction (0,5 USD/tonne), la taxe à l’exportation (0,5 % FOB), et les dividendes sur la participation étatique de 15 % [8][9][10].
La redevance minière de 5 % sur la valeur FOB constitue l’instrument fiscal principal, générant approximativement 720 millions USD par an et représentant 55 à 60 % des revenus totaux de l’État issus du projet (voir Figure 4) [9][10]. Cet instrument présente l’avantage d’être prélevé dès le début de la production, indépendamment de la rentabilité, garantissant des flux de trésorerie immédiats et limitant les risques d’optimisation fiscale. L’impôt sur les sociétés, au taux de 30 % sur les bénéfices nets, représente la deuxième source avec 250 à 350 millions USD annuels (20-25 % des recettes) [8][9]. Son montant varie selon la rentabilité du projet et les mécanismes d’amortissement accéléré prévus dans les conventions, permettant aux sociétés de récupérer leurs investissements initiaux tout en assurant à l’État des recettes croissantes au fil du temps.
Les taxes spécifiques à l’activité minière complètent le dispositif fiscal avec des montants cumulés d’environ 132 millions USD annuels. La taxe d’extraction de 0,5 USD par tonne génère 60 millions USD [3], tandis que la taxe à l’exportation de 0,5 % FOB rapporte 72 millions USD [9]. Bien que représentant individuellement des montants plus modestes, ces taxes unitaires assurent un revenu stable indépendant des fluctuations de prix. Par ailleurs, la participation actionnariale de 15 % de l’État dans les sociétés minières génère des dividendes estimés entre 75 et 100 millions USD annuels (6-7 % des recettes totales), conférant à l’État un double statut de régulateur fiscal et d’actionnaire-investisseur avec un droit de regard sur les décisions stratégiques [4][9][10].
Au total, les revenus attendus pour l’État guinéen se situent entre 1,15 et 1,38 milliard USD par an durant la phase de croisière, représentant près de 60 % des recettes minières nationales projetées à l’horizon 2030 et environ 25 à 30 % des recettes fiscales totales actuelles de l’État [1][2][8][9][10]. Cette amplitude reflète la sensibilité des recettes aux variations des prix internationaux du minerai de fer et aux performances opérationnelles. La gestion de cette rente exceptionnelle s’inscrit dans un cadre de transparence renforcé, avec publication régulière des rapports audits indépendants et réconciliation des paiements conformément aux engagements ITIE [8]. Le Programme Simandou 2040 intègre pleinement ces exigences de gouvernance et prévoit des mécanismes additionnels de traçabilité des flux financiers et d’affectation ciblée des revenus vers les priorités de développement économique et social du pays.
Figure 4 : Revenus de l’État par instrument (1,15-1,38 Md USD/an)

Impact Macroéconomique
Le rebasage du PIB guinéen à 36,3 milliards USD en 2024 constitue un nouveau socle de référence pour l’évaluation de l’impact macroéconomique du projet Simandou [1]. Cette révision méthodologique, qui intègre des secteurs économiques auparavant sous-estimés et actualise les prix de base, offre une représentation plus fidèle de la structure productive nationale et permet d’anticiper avec plus de précision les transformations induites par le méga-projet minier.
À partir de ce point de référence, les projections macroéconomiques établissent une trajectoire de croissance sans précédent : le PIB devra atteindre 56,8 milliards USD à l’horizon 2030, soit une augmentation de 57 % en six ans [1][2][4], puis 82 milliards USD en 2035, représentant une croissance cumulée de 126 % sur la période 2024-2035 [2][3]. Cette dynamique place la Guinée parmi les économies africaines à la croissance la plus rapide de la décennie, avec un taux de croissance annuel moyen projeté de 7,5 à 9 % durant la phase de montée en puissance de Simandou.
Trajectoire du PIB
La trajectoire de croissance du PIB guinéen repose sur trois piliers interdépendants qui transforment en profondeur l’architecture productive guinéenne. Le premier pilier est constitué par l’exploitation minière elle-même, dont la contribution au PIB devrait passer de 14 % en 2024 à 16-18 % en 2030 [1][2], faisant du secteur extractif le moteur principal de l’expansion économique. Avec une production annuelle de 120 millions de tonnes de minerai de fer et une valeur ajoutée estimée entre 9 et 10 milliards USD, Simandou ancre structurellement la Guinée parmi les grands producteurs mondiaux de fer. Le deuxième pilier repose sur les investissements massifs d’infrastructure associés au projet, évalués à 12 milliards USD [4][5], comprenant la construction de 650 km de voie ferrée transguinéenne, le développement du Port de Morebaya (Rio Tinto/Simfer, 60 Mtpa) et du Wharf de Matakong (WCS, 60 Mtpa) pour une capacité portuaire combinée de 120 Mtpa, et la mise en place de corridors énergétiques et logistiques. Ces infrastructures, bien au-delà de leur fonction minière immédiate, constituent des biens publics structurants qui réduisent les coûts de transaction économique et ouvrent de nouvelles opportunités productives dans l’agriculture, l’industrie manufacturière et les services.
Le troisième pilier de croissance découle des effets multiplicateurs générés par Simandou sur les secteurs connexes et l’ensemble de l’économie guinéenne [2][3]. Les dépenses opérationnelles du projet, estimées à plusieurs centaines de millions USD annuellement, créent une demande soutenue pour les services de transport, de logistique, de maintenance industrielle, d’approvisionnement alimentaire et de services aux entreprises, stimulant ainsi le développement de PME locales et de chaînes de valeur domestiques. Les salaires distribués aux dizaines de milliers d’employés directs et indirects du projet alimentent la consommation des ménages, soutenant la croissance du commerce de détail, de l’immobilier, de l’éducation et de la santé privée. Les recettes fiscales exceptionnelles générées par Simandou (1,15 à 1,38 milliard USD annuels) offrent à l’État les moyens de financer des investissements publics dans les infrastructures sociales et économiques, créant ainsi un cercle vertueux de développement. Ces effets multiplicateurs, estimés à un coefficient compris entre 1,8 et 2,2, signifient que chaque dollar de valeur ajoutée directement créé par Simandou génère entre 0,8 et 1,2 dollar de valeur ajoutée supplémentaire dans le reste de l’économie.
Malgré cette trajectoire favorable, la forte dépendance de la croissance économique vis-à-vis du secteur minier comporte des risques structurels significatifs qui nécessitent une gestion macroéconomique prudente et des politiques de diversification proactives. La volatilité des prix internationaux du minerai de fer, historiquement caractérisée par des cycles d’expansion et de contraction brutaux, expose l’économie guinéenne à des chocs externes susceptibles de compromettre la stabilité macroéconomique et budgétaire. Le syndrome hollandais (Dutch disease), phénomène par lequel l’afflux massif de devises minières provoque une appréciation du taux de change réel et une perte de compétitivité des secteurs non miniers, constitue une menace pour la diversification économique et le développement de l’agriculture et de l’industrie manufacturière. Le Programme Simandou 2040, conscient de ces enjeux, intègre des mécanismes de stabilisation macroéconomique (fonds de stabilisation des recettes minières, règles budgétaires contra-cycliques) et des politiques sectorielles visant à promouvoir la transformation structurelle de l’économie au-delà du secteur extractif, conformément aux principes de gestion durable des ressources naturelles et de développement économique inclusif.
Figure 5 : Trajectoire du PIB guinéen 2024-2035
 L’illustration de l’impact économique du projet présente deux indicateurs distincts : le PIB (richesse totale en milliards USD) et le taux de croissance annuel (variation en %). Il est essentiel de comprendre que le PIB mesure la taille de l’économie tandis que le taux de croissance mesure sa vitesse de progression. Entre 2024 et 2028, le PIB passe de 36.5 Mds à 56.8 Mds USD (+56%) avec un taux de croissance culminant à +14% grâce aux investissements massifs. En 2029-2030, le taux de croissance ralentit à +3%, mais le PIB continue d’augmenter de 56.8 Mds à 60.2 Mds USD – l’économie grandit simplement moins vite durant cette transition. De 2031 à 2035, le PIB atteint 82.5 Mds USD avec un taux stabilisé à +6-7%. Sur l’ensemble de la période, le PIB augmente de 126% sans aucune baisse. Un taux de croissance qui diminue ne signifie pas que l’économie régresse, mais qu’elle progresse à un rythme plus modéré. Le PIB augmente continuellement chaque année, démontrant l’impact positif durable du projet Simandou.
L’illustration de l’impact économique du projet présente deux indicateurs distincts : le PIB (richesse totale en milliards USD) et le taux de croissance annuel (variation en %). Il est essentiel de comprendre que le PIB mesure la taille de l’économie tandis que le taux de croissance mesure sa vitesse de progression. Entre 2024 et 2028, le PIB passe de 36.5 Mds à 56.8 Mds USD (+56%) avec un taux de croissance culminant à +14% grâce aux investissements massifs. En 2029-2030, le taux de croissance ralentit à +3%, mais le PIB continue d’augmenter de 56.8 Mds à 60.2 Mds USD – l’économie grandit simplement moins vite durant cette transition. De 2031 à 2035, le PIB atteint 82.5 Mds USD avec un taux stabilisé à +6-7%. Sur l’ensemble de la période, le PIB augmente de 126% sans aucune baisse. Un taux de croissance qui diminue ne signifie pas que l’économie régresse, mais qu’elle progresse à un rythme plus modéré. Le PIB augmente continuellement chaque année, démontrant l’impact positif durable du projet Simandou.
L’illustration des contributions sectorielles à la croissance du PIB en 2030, ci-dessous, révèle un impact économique diversifié : les services et multiplicateurs représentent 35% (commerce, transport, finance), suivis des autres secteurs à 32% (agriculture, industrie), du secteur minier à 18% (extraction directe), et des infrastructures-construction à 15%, démontrant que chaque dollar investi dans le projet génère des bénéfices dans l’ensemble de l’économie guinéenne. Les investissements totaux de 12 milliards USD se répartissent entre la mine et équipements (4.5 Mds, 37.5%), le chemin de fer trans-guinéen de 650 km (3.8 Mds, 31.7%), les infrastructures portuaires avec une capacité combinée de 120 millions de tonnes par an (2.2 Mds, 18.3%), et les infrastructures énergétiques et de télécommunications (1.5 Mds, 12.5%), créant ainsi un écosystème complet qui transformera durablement l’économie nationale. Il faut noter que les infrastructures portuaires du projet se composent de deux installations distinctes : le Port de Morébayah (60 Mtpa, Rio Tinto/Simfer), situé dans l’estuaire de la rivière Morébayah près de Senguelen (préfecture Forécariah), et le Wharf de Matakong (60 Mtpa, WCS), situé sur l’île de Matakong. Cette configuration duale, finalisée par l’accord de décembre 2023, permet une capacité portuaire combinée de 120 millions de tonnes par an, propriété de la Compagnie du TransGuinéen (CTG).
Figure 6 : Contributions Sectorielles et Investissement d’Infrastructure
Impact sur l’Emploi

Le projet Simandou doit générer un total de 110 000 emplois durant sa phase de croisière, représentant une contribution significative au marché du travail guinéen et constituant l’un des plus importants programmes de création d’emplois de l’histoire économique du pays [1][2][3]. Cette création d’emplois se décompose en trois catégories interdépendantes : 15 000 emplois directs dans l’exploitation minière, les opérations ferroviaires et portuaires [4], 40 000 emplois indirects dans les entreprises fournisseurs de biens et services au projet, et 55 000 emplois induits dans les secteurs de l’économie stimulés par les dépenses des salariés et des entreprises liées au projet [2][3]. L’effet multiplicateur d’emploi de 7,3 (chaque emploi direct générant 6,3 emplois supplémentaires) se révèle supérieur à la moyenne observée dans les projets miniers comparables en Afrique subsaharienne, où le ratio varie généralement entre 5 et 6 [1][2][3]. Cette performance exceptionnelle s’explique par l’ampleur des infrastructures associées au projet, la longueur de la chaîne logistique intégrée (mine-rail-port), et les politiques de contenu local qui favorisent l’intégration d’entreprises et de travailleurs guinéens dans la chaîne de valeur minière.
Les 15 000 emplois directs se répartissent entre l’extraction minière proprement dite (exploitation, traitement du minerai, maintenance des équipements lourds), les opérations ferroviaires (conduite des trains, maintenance de la voie ferrée, gestion du trafic), et les activités portuaires (chargement des navires, stockage, administration portuaire) [4]. Ces emplois, majoritairement qualifiés ou semi-qualifiés, offrent des rémunérations significativement supérieures à la moyenne nationale et s’accompagnent de programmes de formation technique et professionnelle visant à développer les compétences locales dans les métiers miniers et logistiques. Les 40 000 emplois indirects concernent les entreprises sous-traitantes et fournisseurs de services industriels (transport routier, maintenance mécanique, fourniture d’équipements), les services aux entreprises (restauration collective, sécurité, nettoyage industriel), et les fournisseurs d’intrants (carburants, pièces détachées, fournitures) [2][3]. Les 55 000 emplois induits émergent dans les secteurs de services de proximité stimulés par l’augmentation du pouvoir d’achat des travailleurs du projet et de leurs familles : commerce de détail, restauration, logement, éducation privée, santé, services financiers et télécommunications [2][3]. Cette structure d’emploi favorise une diffusion géographique large des bénéfices du projet, bien au-delà des sites miniers et des infrastructures de transport, contribuant ainsi au développement économique régional et à la réduction de la pauvreté dans les zones d’influence du projet.
La réalisation de ce potentiel de création d’emplois requiert des investissements massifs et soutenus dans la formation professionnelle et le développement des compétences techniques de la main-d’œuvre guinéenne. Le Programme Simandou 2040 intègre des mécanismes de formation continue et d’apprentissage en situation de travail, associant les consortiums miniers, les institutions publiques de formation professionnelle, et les partenaires internationaux spécialisés dans le développement des compétences minières. Les défis sont considérables : le système éducatif et de formation professionnelle guinéen doit être renforcé pour produire annuellement des milliers de techniciens et d’ouvriers qualifiés dans les métiers miniers, ferroviaires, portuaires et logistiques ; les femmes doivent être activement intégrées dans ces programmes de formation pour assurer une inclusion économique équitable ; et des mécanismes de reconversion professionnelle doivent être anticipés pour accompagner les travailleurs lors de la phase de déclin du projet, plusieurs décennies dans le futur. Les politiques de contenu local, inscrites dans les conventions minières, fixent des objectifs progressifs de guinéisation des emplois et des sous-traitances, créant ainsi une pression positive pour le développement accéléré du capital humain national et l’émergence d’un tissu entrepreneurial local capable de capter une part croissante de la valeur ajoutée du projet.
Figure 7 : Création d’emplois (Multiplicateur 7,3x)
15k directs + 40k indirects + 55k induits = 110k total
Viabilité Économique et Financière

La viabilité économique et financière du projet Simandou constitue un pilier fondamental du Programme Simandou 2040, conditionnant la capacité de la Guinée à transformer durablement cette ressource minière exceptionnelle en un vecteur de développement économique inclusif et de prospérité partagée. L’évaluation de cette viabilité repose sur une analyse multidimensionnelle intégrant quatre perspectives complémentaires : la soutenabilité de la dette publique dans un contexte de mobilisation significative de ressources pour le financement des infrastructures et des services publics, la rentabilité financière du projet minier pour les consortiums investisseurs qui détermine leur engagement à long terme, la résilience macroéconomique du pays face aux chocs exogènes (volatilité des prix des matières premières, crises financières internationales, aléas climatiques), et la capacité de l’État à capter et à gérer efficacement la rente minière au service des objectifs de développement national.
Les projections financières élaborées dans le cadre du Programme Simandou 2040 s’appuient sur des hypothèses macroéconomiques prudentes, des scénarios de sensibilité testant la robustesse des résultats face aux variations des paramètres critiques (prix du minerai de fer, coûts opérationnels, taux de change), et des mécanismes de gouvernance budgétaire visant à prévenir les risques de surendettement, de volatilité excessive des dépenses publiques, et de mauvaise allocation des ressources minières. Cette section examine successivement la trajectoire de soutenabilité de la dette publique sur l’horizon 2024-2035, les indicateurs de rentabilité et de viabilité financière du projet minier, et les mécanismes de gestion des risques économiques et financiers associés à cette transformation structurelle majeure de l’économie guinéenne, démontrant que le projet Simandou, s’il est accompagné de politiques macroéconomiques prudentes et de réformes institutionnelles appropriées, offre une trajectoire de développement économiquement viable, financièrement soutenable, et compatible avec les objectifs de stabilité macroéconomique et de réduction de la pauvreté du pays.
Soutenabilité de la Dette Publique
La trajectoire de la dette publique guinéenne sur la période 2024-2035 demeure largement soutenable et compatible avec les standards internationaux de viabilité de la dette, malgré les besoins d’investissement massifs associés au développement des infrastructures économiques et sociales du pays [2][3][7]. Le ratio dette publique/PIB devrait connaître une baisse progressive et soutenue, passant de 35,2 % en 2024 à 29,3 % en 2035, soit une diminution de près de 6 points de pourcentage sur la période [2][3][7]. Cette performance place confortablement la Guinée bien en dessous du seuil de 50 % du ratio dette/PIB établi par le Fonds Monétaire International comme indicateur de viabilité de la dette pour les pays à faible revenu, offrant ainsi une marge de manœuvre budgétaire significative pour financer les politiques publiques de développement. Cette amélioration structurelle du profil d’endettement s’explique par la conjugaison de deux dynamiques favorables : d’une part, la croissance exceptionnelle du PIB portée par la montée en puissance du projet Simandou qui élargit mécaniquement la base de calcul du ratio [1][2], et d’autre part, une gestion budgétaire prudente caractérisée par une discipline dans l’accumulation de nouvelles dettes et une priorisation des investissements publics à forte rentabilité économique et sociale [3][7]. Le Programme Simandou 2040 intègre pleinement ces exigences de soutenabilité de la dette dans ses projections macroéconomiques et ses cadres de dépenses à moyen terme, garantissant ainsi la crédibilité financière de la stratégie nationale de développement.
Cette trajectoire favorable de soutenabilité de la dette reste toutefois conditionnée à la réalisation de plusieurs hypothèses macroéconomiques critiques et à la mise en œuvre de politiques de gestion budgétaire rigoureuses face aux risques économiques exogènes. Le principal facteur de risque identifié concerne la stabilité des prix internationaux du minerai de fer, dont le maintien à des niveaux supérieurs à 100 USD la tonne constitue une condition essentielle à la matérialisation des recettes publiques projetées et, par conséquent, à la soutenabilité du profil d’endettement [3]. Une baisse prolongée des prix du fer en dessous de ce seuil critique réduirait significativement les revenus fiscaux issus de Simandou (redevances, impôts sur les sociétés, taxes d’exportation), dégradant ainsi l’équilibre budgétaire et potentiellement contraignant l’État à recourir à un endettement supplémentaire pour financer ses dépenses courantes et ses investissements prioritaires. Les autres risques incluent les chocs climatiques susceptibles d’affecter la production agricole et la croissance économique, les tensions géopolitiques régionales pouvant perturber les chaînes d’approvisionnement et les routes commerciales, et les chocs financiers internationaux susceptibles de renchérir les conditions d’accès aux marchés de capitaux. Face à ces vulnérabilités, le Programme Simandou 2040 préconise la constitution d’un fonds de stabilisation budgétaire alimenté par une part des recettes minières en période de prix élevés, l’adoption de règles budgétaires contra-cycliques limitant les dépenses publiques en fonction des recettes structurelles plutôt que conjoncturelles, et la diversification des sources de financement du développement en combinant emprunts concessionnels, partenariats public-privé et investissements directs étrangers, afin de préserver durablement la viabilité de la dette publique et la stabilité macroéconomique du pays.
Figure 8 : Soutenabilité de la dette publique 2024-2035
Dette/PIB : 35,2% (2024) → 29,3% (2035) – Sous le seuil FMI (50%)
Évolution du PIB par Habitant

Le PIB par habitant guinéen devrait connaître une progression exceptionnelle sur la période 2024-2035, passant de 2 700 USD en 2024 à 3 600 USD en 2030, puis à 4 800 USD en 2035, soit une augmentation cumulée de 78 % en onze ans [1][2][3]. Cette trajectoire de croissance du revenu moyen par personne, largement supérieure à la moyenne observée dans les pays d’Afrique subsaharienne sur la période récente, traduit l’impact direct du projet Simandou sur le niveau de vie des populations guinéennes et leur capacité à accéder aux biens et services essentiels (alimentation, santé, éducation, logement). L’augmentation de 900 USD du PIB par habitant entre 2024 et 2030, puis de 1 200 USD supplémentaires entre 2030 et 2035, reflète non seulement la croissance rapide du PIB global portée par l’exploitation minière et les secteurs connexes, mais également une dynamique démographique relativement modérée qui permet une diffusion effective de la richesse créée au niveau individuel. Cette performance positionne la Guinée sur une trajectoire de rattrapage économique vis-à-vis des pays émergents les plus performants et ouvre des perspectives d’amélioration substantielle des indicateurs sociaux (réduction de la pauvreté, accès aux services de base, développement du capital humain) si la croissance économique s’accompagne de politiques redistributives appropriées et d’investissements massifs dans les secteurs sociaux.
Cette évolution du PIB par habitant traduit une transformation structurelle majeure du statut économique de la Guinée dans la classification internationale des niveaux de développement. Le pays, actuellement classé parmi les pays à revenu intermédiaire inférieur (lower-middle-income country) selon la typologie de la Banque mondiale, devrait franchir le seuil de 4 125 USD par habitant pour accéder au statut de pays à revenu intermédiaire supérieur (upper-middle-income country) aux alentours de 2035 [2][3]. Ce changement de catégorie économique, bien qu’essentiellement symbolique, comporte des implications concrètes significatives : il témoigne d’une convergence progressive vers les standards de vie des économies émergentes avancées, améliore la perception internationale du risque-pays et l’attractivité pour les investisseurs étrangers, mais s’accompagne également d’une révision à la hausse des conditions d’accès à l’aide publique au développement et aux financements concessionnels des institutions multilatérales. La réussite de cette transition vers un niveau de développement supérieur nécessite que la croissance du revenu moyen s’accompagne d’une réduction effective des inégalités de revenus et de richesses, d’une inclusion économique des populations rurales et des catégories vulnérables, et d’une transformation productive diversifiée au-delà du seul secteur extractif, conformément aux objectifs du Programme Simandou 2040 de bâtir une prospérité inclusive et durable fondée sur une économie diversifiée et résiliente.

Figure 9 : Évolution du PIB par habitant 2024-2035
2 700 USD (2024) → 4 800 USD (2035) – Atteinte de la catégorie upper-middle-income

Analyse de Sensibilité et Gestion des Risques
L’analyse de sensibilité des revenus de l’État guinéen aux variations des prix internationaux du minerai de fer révèle une corrélation forte et directe entre ces deux variables, soulignant la vulnérabilité structurelle des finances publiques face aux chocs exogènes sur les marchés mondiaux des matières premières [2][3]. Au prix de référence de 120 USD par tonne, considéré comme le scénario central des projections macroéconomiques du Programme Simandou 2040, les revenus annuels de l’État issus du projet se situent dans une fourchette de 1,15 à 1,38 milliard USD, comprenant les redevances minières (5 % FOB), l’impôt sur les sociétés (30 % des bénéfices), les taxes d’extraction et d’exportation, ainsi que les dividendes sur la participation étatique de 15 % [8][9].
Cette hypothèse de prix, basée sur les moyennes historiques à moyen terme et les projections des institutions internationales spécialisées dans les marchés des métaux, constitue le fondement des cadres budgétaires pluriannuels et des planifications sectorielles du gouvernement guinéen. Cependant, la volatilité historiquement élevée des cours du minerai de fer, caractérisée par des fluctuations pouvant atteindre 50 % ou plus d’une année sur l’autre en fonction des cycles économiques mondiaux, de la demande chinoise (principal importateur mondial représentant 70 % de la demande globale), et des dynamiques d’offre des grands producteurs (Australie, Brésil, Inde), impose une analyse rigoureuse des scénarios alternatifs et de leurs implications pour la soutenabilité budgétaire et macroéconomique du pays.
Sensibilité des Revenus au Prix du Minerai de Fer
L’évaluation quantitative des scénarios de prix alternatifs démontre l’ampleur des variations potentielles des revenus publics et leurs conséquences sur la capacité de l’État à financer ses politiques de développement. Dans un scénario pessimiste de repli durable des cours à 80 USD par tonne, niveau observé historiquement lors des phases de récession économique mondiale ou de surinvestissement dans la capacité minière globale, les recettes annuelles de l’État issues de Simandou chuteraient à une fourchette de 750 à 900 millions USD, soit une réduction de 35 à 40 % par rapport au scénario de référence [2]. Cette contraction massive des revenus miniers compromettrait significativement l’équilibre budgétaire, forçant l’État soit à réduire drastiquement ses dépenses d’investissement et de fonctionnement, avec des impacts négatifs sur les services publics et les programmes sociaux, soit à recourir à un endettement supplémentaire pour combler le déficit, au risque de dégrader la soutenabilité de la dette publique et d’augmenter les coûts de financement futurs.
À l’inverse, dans un scénario optimiste de hausse des cours à 150 USD par tonne, situation pouvant survenir en cas de forte reprise de la demande mondiale, de contraintes d’approvisionnement chez les grands producteurs, ou de politiques climatiques favorisant l’acier vert produit à partir de minerai de haute qualité comme celui de Simandou, les revenus publics atteindraient 1,7 à 2,0 milliards USD annuellement, soit une augmentation de 45 à 50 % par rapport au scénario central [2]. Cette manne financière exceptionnelle offrirait à l’État des marges de manœuvre considérables pour accélérer les investissements dans les infrastructures économiques et sociales, réduire la dette publique, ou constituer des réserves financières pour les périodes de prix défavorables, à condition que des mécanismes de gouvernance appropriés préviennent les risques de gaspillage, de corruption, ou de dépenses procycliques qui amplifieraient l’instabilité macroéconomique.
L’analyse de sensibilité révèle ainsi une relation quasi-linéaire entre les prix du minerai de fer et les revenus publics, avec un coefficient de sensibilité approximatif de 10 millions USD de revenus supplémentaires pour chaque dollar d’augmentation du prix par tonne. Cette élasticité élevée des recettes publiques aux fluctuations des cours mondiaux souligne la vulnérabilité structurelle des finances guinéennes face à un marché caractérisé par une volatilité historique importante, les prix ayant oscillé entre 50 et 180 USD par tonne au cours de la dernière décennie selon les données de la Banque mondiale et du World Steel Association [2][17]. Cette dépendance aux marchés internationaux des matières premières expose l’économie guinéenne à des chocs exogènes imprévisibles, rendant la planification budgétaire pluriannuelle particulièrement complexe et nécessitant l’adoption de stratégies robustes de gestion des risques macroéconomiques pour assurer la stabilité et la prévisibilité des finances publiques indispensables au financement continu des investissements prioritaires en capital humain, infrastructures et services sociaux de base.
Figure 10 : Sensibilité des revenus au prix du minerai de fer
Prix < 90 USD/t : Déficit | Prix 120 USD/t : 1,15-1,38 Md | Prix 150 USD/t : 1,85 Md
Gestion des Risques et Stratégies de Mitigation

Face à la volatilité structurelle des revenus miniers et ses implications potentiellement déstabilisantes pour l’économie guinéenne, la mise en place d’un fonds souverain de stabilisation constitue un instrument essentiel de gestion des risques macroéconomiques et de lissage intertemporel de la consommation publique [3][7]. Ce fonds de stabilisation, inspiré des meilleures pratiques internationales observées dans les pays exportateurs de ressources naturelles (Chili avec son Fonds de stabilisation économique et sociale, Norvège avec son Fonds pétrolier, Botswana avec son Pula Fund), fonctionnera selon des règles budgétaires contra-cycliques transparentes et prévisibles : en période de prix élevés (supérieurs au prix de référence à long terme), une part prédéterminée des recettes exceptionnelles sera automatiquement épargnée dans le fonds plutôt que dépensée immédiatement, permettant d’éviter les pressions inflationnistes, la surévaluation du taux de change (syndrome hollandais), et l’accumulation de dépenses récurrentes non soutenables.
En période de prix déprimés (inférieurs au prix de référence), le fonds sera mobilisé pour compléter les recettes courantes et maintenir un niveau stable de dépenses publiques prioritaires, protégeant ainsi les investissements sociaux et infrastructurels critiques des chocs temporaires sur les marchés internationaux. La gouvernance du fonds doit s’appuyer sur des principes de transparence (publication régulière des comptes et des transactions), de professionnalisation de la gestion (stratégies d’investissement diversifiées et prudentes privilégiant la préservation du capital), et de redevabilité démocratique (supervision parlementaire et audit indépendant). Le Programme Simandou 2040 préconise la création rapide de ce fonds de stabilisation, doté d’un cadre juridique et institutionnel robuste, comme condition nécessaire à la transformation de la richesse minière volatile en un développement économique stable, prévisible, et bénéfique pour les générations présentes et futures de Guinéens.
Au-delà du fonds de stabilisation budgétaire, d’autres stratégies complémentaires de gestion des risques associés à la volatilité des prix du minerai de fer doivent être envisagées dans le cadre d’une approche globale de résilience macroéconomique. La diversification économique structurelle, visant à réduire progressivement la dépendance excessive aux recettes minières en développant d’autres secteurs productifs (agriculture, industrie manufacturière, services, tourisme), constitue la stratégie de long terme la plus efficace pour immuniser les finances publiques contre les chocs sur un seul marché de matières premières. Les clauses contractuelles de partage des risques dans les conventions minières, telles que les mécanismes d’ajustement automatique des redevances en fonction des prix (taux de redevance croissant avec les prix pour capter une part plus importante de la rente en période favorable), peuvent améliorer la résilience budgétaire tout en préservant l’attractivité du pays pour les investisseurs.
Les instruments financiers de couverture (hedging), bien que techniquement complexes et coûteux, peuvent être explorés pour sécuriser une partie des revenus futurs contre les baisses de prix, particulièrement pour les tranches de recettes affectées au service de la dette publique. Enfin, le renforcement de la capacité administrative de l’État en matière de prévision macroéconomique, de planification budgétaire flexible, et de gestion de trésorerie sophistiquée constitue un investissement institutionnel indispensable pour naviguer efficacement dans l’environnement incertain des marchés mondiaux de matières premières et garantir que la richesse minière serve effectivement les objectifs de développement durable et de prospérité partagée inscrits au cœur du Programme Simandou 2040.
Figure 11 : Stratégies de Gestion des Risques

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
L’évaluation économique et financière intégrée du projet Simandou et du Programme Simandou 2040, fondée sur des analyses macroéconomiques rigoureuses, des projections budgétaires prudentes, et des scénarios de sensibilité testant la robustesse des résultats face aux principaux risques identifiés, confirme sans ambiguïté la viabilité économique et financière de cette transformation structurelle majeure de l’économie guinéenne [1][2][3]. Les projections établissent une trajectoire de croissance exceptionnelle avec un doublement du PIB d’ici 2035, passant de 36,3 milliards USD en 2024 à plus de 82 milliards USD en 2035, soit une expansion économique de 126 % sur onze ans portée par l’exploitation minière, les investissements massifs en infrastructures (12 milliards USD), et les effets multiplicateurs sur l’ensemble des secteurs productifs. La création de 110 000 emplois directs, indirects et induits, avec un multiplicateur d’emploi de 7,3 supérieur à la moyenne des projets miniers africains, témoigne de l’ampleur des retombées socio-économiques attendues et de la capacité du projet à impulser une dynamique de développement inclusif touchant des centaines de milliers de Guinéens à travers l’amélioration des revenus, l’accès élargi aux services essentiels, et les opportunités d’entrepreneuriat dans les chaînes de valeur locales. La soutenabilité de la dette publique, avec un ratio dette/PIB en baisse continue de 35,2 % en 2024 à 29,3 % en 2035, bien en deçà du seuil de prudence de 50 % établi par le FMI, offre à l’État guinéen une marge de manœuvre budgétaire significative pour financer les politiques publiques prioritaires tout en préservant la stabilité macroéconomique et la confiance des marchés financiers internationaux.
La matérialisation de ces perspectives favorables et la transformation effective de la richesse minière en développement durable et prospérité partagée restent conditionnées au respect rigoureux de quatre exigences fondamentales identifiées par l’analyse de sensibilité et l’évaluation des risques [3][4][5]. Premièrement, la stabilité des prix internationaux du minerai de fer au-dessus du seuil critique de 100 USD par tonne constitue une condition macroéconomique essentielle à la viabilité budgétaire du projet, une chute prolongée des cours en dessous de ce niveau compromettra significativement les recettes publiques et imposera des ajustements budgétaires douloureux ; la constitution rapide d’un fonds souverain de stabilisation, alimenté par les recettes exceptionnelles en période de prix favorables et mobilisé pour lisser les dépenses publiques en période de prix défavorables, représente l’instrument privilégié de gestion de cette volatilité structurelle.
Deuxièmement, une gouvernance rigoureuse et une transparence totale dans la gestion de la rente minière, conformément aux standards de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE), s’imposent comme conditions centrales pour prévenir les risques de corruption, de détournement, de mauvaise allocation des ressources, et de capture de la rente par des intérêts particuliers au détriment de l’intérêt général [8]. Les mécanismes de publication systématique des rapports d’audit indépendant des comptes, de réconciliation des paiements, et de traçabilité de l’affectation des ressources constituent l’un des socles institutionnels indispensable à la légitimité sociale du projet et à la confiance des citoyens et des partenaires internationaux.
Troisièmement, la diversification économique stratégique, visant à réduire progressivement la dépendance excessive aux recettes minières volatiles en développant des secteurs productifs alternatifs (agriculture modernisée, secteur tertiaire, agro-industrie, industrie manufacturière légère, services, tourisme), représente l’une des meilleures stratégie de long terme garantissant la résilience de l’économie face aux chocs sur les marchés de matières premières et la durabilité du développement au-delà du cycle de vie du projet minier. Quatrièmement, le développement accéléré du capital humain guinéen à travers des investissements massifs et soutenus dans l’éducation, la formation professionnelle, la santé, et la recherche-développement, constitue le fondement ultime de toute transformation économique durable, conditionnant la capacité du pays à absorber les technologies modernes, à innover, à accroître la productivité, et à converger vers les standards de vie des économies émergentes avancées.
Le Programme établit le cadre stratégique et opérationnel nécessaire pour transformer la rente extractive en un développement durable et inclusif au bénéfice des générations présentes et futures [1][2]. Il combine la mobilisation optimale des ressources minières, l’investissement dans les infrastructures structurantes et l’allocation des recettes vers les secteurs sociaux essentiels comme l’éducation, la santé et l’eau. Le programme promeut également la diversification économique, la transparence dans la gestion publique et la mise en place d’instruments de stabilisation budgétaire. Sa réussite repose sur un engagement politique fort, une appropriation nationale et une discipline collective dans l’application des principes de gouvernance.
Si la viabilité économique du projet est démontrée, une évaluation complète exige l’intégration des dimensions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) [6]. La prochaine publication de la série examinera les impacts écologiques, les enjeux sociaux tels que le déplacement des populations ou l’équité de genre, ainsi que les exigences de gouvernance participative et de responsabilité sociale. L’intégration des critères ESG dans la conception et le suivi du projet constitue une condition essentielle de durabilité et d’adhésion internationale. En plaçant le développement durable au cœur de sa vision, le Programme Simandou 2040 s’aligne sur les Objectifs de Développement Durable de l’Agenda 2030 des Nations Unies.
Adama Guilavogui, Ph.D., JD
Références
[1] Institut National de la Statistique. (2024). Note méthodologique sur le rebasage du PIB 2024. INS.
[2] Banque mondiale. (2023). Guinea Economic Update 2023: Investing in Sustainable Growth. World Bank Group.
[3] Banque africaine de développement. (2023). Guinea Country Report 2023. BAD.
[4] République de Guinée. (2022, mars). Décret de création de la Compagnie du TransGuinéen (CTG). Journal officiel.
[5] International Finance Corporation. (2014). Project Finance Report – Simandou Infrastructure. IFC.
[6] Winning Consortium Simandou. (2019). Project Development Master Plan. WCS Publications.
[7] Fonds monétaire international. (2023). Guinea: Article IV Consultation Report 2023. IMF.
[8] Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives Guinée. (2024). Rapport de validation 2023. ITIE Guinée.
[9] République de Guinée. (2011). Code minier (Loi L/2011/006/CNT du 9 septembre 2011, amendée 2013). Journal officiel.
[10] Rio Tinto Simfer. (2023). Technical Report on Simandou Blocks 3-4 Mineral Reserves and Resources. Rio Tinto Group.
[11] Chalco Iron Ore Holdings. (2023). Simandou Project Feasibility Study Update. Aluminum Corporation of China.
[12] Rio Tinto Simfer. (2022). Simandou Blocks 3-4: Proven and Probable Reserves Technical Report (1.5 Bt @ 65.3% Fe). Rio Tinto Group.
[13] Rio Tinto Simfer. (2022). Simandou Mineral Resources Outside Reserves (1.4 Bt @ 66.1% Fe). Rio Tinto Technical Services.
[14] Winning Consortium Simandou. (2023). Blocks 1-2 Reserves and Resources Statement (1.8 Bt @ 65.5% Fe). WCS.
[15] République de Guinée, Ministère des Mines et de la Géologie. (2023). Évaluation des ressources minérales de Simandou. MMG.
[16] République de Guinée, Ministère des Mines. (2024). Rapport sur les ressources minérales inférées de Simandou. MMG.
[17] World Steel Association. (2023). World Steel in Figures 2023. WSA. https://worldsteel.org
[18] International Energy Agency. (2023). Iron and Steel Technology Roadmap – Towards Net Zero. IEA Publications.