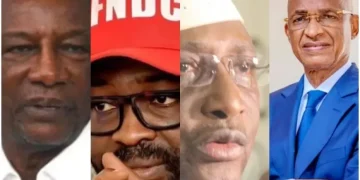Ce 3 novembre marque plus qu’une échéance administrative : il incarne une respiration politique dans l’histoire de la Guinée contemporaine. La date limite de dépôt des candidatures n’est pas qu’une procédure électorale ; elle concentre toutes les tensions, les interrogations et les symboles d’une transition arrivée à son heure de vérité.
Depuis des semaines, la scène politique nationale vit dans une attente feutrée, mais chargée d’électricité. Les formations politiques peaufinent leurs stratégies, les chancelleries scrutent, les citoyens s’interrogent. Et au centre de cette effervescence, un silence : celui du Président de la transition guinéenne, le Général Mamadi Doumbouya. Ce silence, paradoxalement, parle. Il n’est ni retrait, ni indifférence : il est calcul, posture et message. Il institue un espace d’incertitude qui, dans la grammaire du pouvoir, devient un instrument de contrôle du temps politique.
La question désormais centrale est claire : le Général Mamadi Doumbouya sera-t-il candidat, pour le bien de la République ?
Posée ainsi, cette interrogation transcende le registre partisan. Elle convoque la science politique dans ce qu’elle a de plus essentiel : l’analyse du rapport entre légitimité, stabilité et leadership.
Dans un État en transition, le dilemme est toujours le même : comment achever le changement sans déstabiliser l’ordre naissant ? Comment éviter que la rupture, si nécessaire soit-elle, ne tourne à la dislocation ?
Le Général Mamadi Doumbouya, en incarnant depuis le 05 Septembre 2021 le discours de refondation, a donné corps à une idée : celle d’un État réconcilié avec lui-même, d’une souveraineté assumée et d’une verticalité restaurée. Quatre ans plus tard, le pays se trouve devant une alternative cruciale : poursuivre cette dynamique avec son initiateur ou risquer une discontinuité au nom du principe.
Dans les faits, la Transition a consolidé le pouvoir exécutif, restructuré les appareils de sécurité, réaffirmé la présence de l’État sur le territoire et replacé la notion de souveraineté au centre du discours national. Ces avancées, bien qu’incomplètes, ont redonné à l’autorité publique une consistance longtemps érodée. Et dans un contexte régional marqué par les turbulences institutionnelles, la stabilité guinéenne apparaît comme un acquis rare et fragile à la fois.
Dès lors, si le Général Doumbouya choisissait de se porter candidat, ce choix pourrait être interprété non comme une trahison de l’esprit de la Transition, mais comme une stratégie de consolidation. Loin d’un simple désir de continuité personnelle, cette décision pourrait viser à préserver les fondements d’une refondation encore inachevée, à garantir la stabilité interne et à éviter la rechute dans le désordre cyclique des alternances mal préparées.
Autrement dit, cette candidature, si elle venait à se confirmer, pourrait constituer une véritable opportunité pour la République : celle d’un prolongement maîtrisé du processus de reconstruction institutionnelle, dans un cadre électoral qui confère au projet de refondation une légitimité nouvelle celle des urnes.
Rien n’est encore acté. Mais les signes, eux, sont visibles : le discours de souveraineté s’intensifie, la communication institutionnelle se resserre, les appuis locaux se multiplient. Au regard de ce dispositif soigneusement mis en place, tout porte à croire que le silence n’est pas une hésitation, mais une préparation.
Ainsi, en ce dernier jour de dépôt des candidatures, la Guinée ne se trouve pas simplement devant un choix électoral. Elle se tient au seuil d’un destin politique : entre la mémoire de ses transitions passées et la possibilité, enfin, d’une stabilité durable.
Quoi qu’il en soit, ce soir, la République retient son souffle.
Par Christian Desco Condé, Politologue, Enseignant-chercheur à l’Université Général Lansana Conte de Sonfonia Conakry.